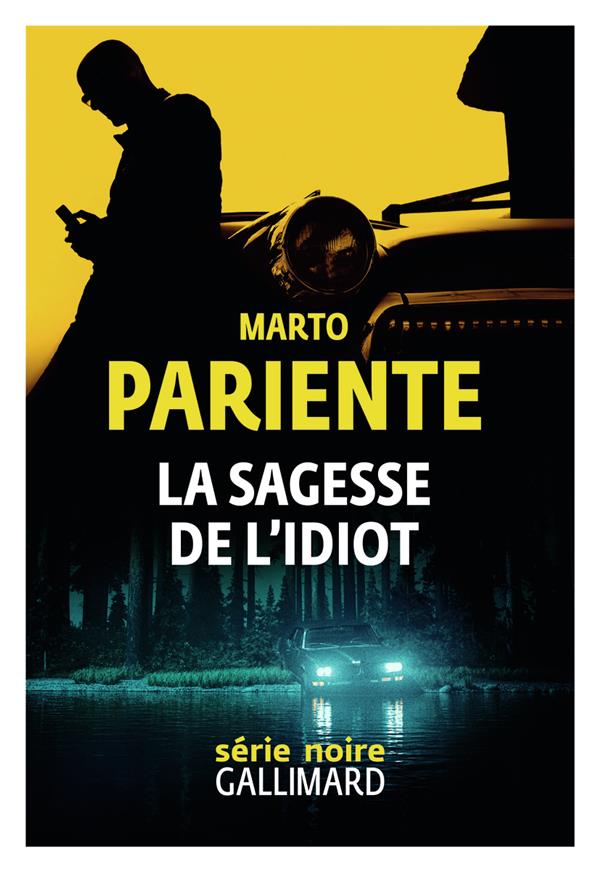Revoilà Milo Malart, le flic barcelonais d’Aro Sainz de la Masa dans un titre qui a le mérite de la simplicité : Malart.
Milo Malart s’est tout seul mis en marge de son équipe de flics barcelonais. Depuis son incapacité à faire inculper un couple de psychopathes, Ivo Parés et Monica Morera, trentenaires, rejetons de la très haute société catalane, il est obsédé par son impuissance et semble perdre les pédales.
Ses partenaires, et en particulier Rebeca Mercader, sa binôme, s’inquiètent. Puis tout bascule quand les corps des d’Ivo et Monica sont repêchés en mer, et que sur leur yacht on trouve partout les empreintes de Malart. Et Milo qui reste introuvable. Alors que la presse, le juge et les réseaux sociaux enflammés par les familles des deux morts demandent sa peau, seule Rebecca et ses collègues vont tenter de sauver Malart.
Comme les précédents romans de la série, Malart, sans être un polar exceptionnel, c’est du costaud, du solide. Je ne sais pas mettre le doigt sur ce qui fait que je suis moins débordant d’enthousiasme que pour un Soneri ou une Boccanera, mais ça fonctionne quand même très bien.
Les méchants sont peut-être un peu trop caricaturaux, trop faciles à identifier, et manquant singulièrement de charisme. Ce sont juste des pourris qui utilisent leur puissance financière sans aucune subtilité, au point qu’on ne peut imaginer un instant qu’ils puissent gagner. C’est peut-être là la limite du roman.
Pour le reste, l’intrigue est bien construite, les personnages de l’équipe de flics attachants, et on a une belle description d’une ville et d’une région gangrénées, comme ailleurs, pas la corruption et le pouvoir de l’argent. Comme le dit (beaucoup mieux) un des personnages du génial Terry Pratchett : « Les grandes familles ont des fortunes si anciennes qu’on a oublié les crimes commis pour les amasser ».
C’est à cela que se heurtent Malart et ses collègues.
Aro Sainz de la Masa / Malart, (Malart, 2023), Actes Noirs (2024) traduit de l’espagnol par Serge Mestre.